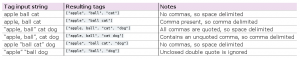4 jours après la fin des Cong, il est temps pour moi de faire le bilan de cette deuxième est, en tout cas à mon sens, excellente édition.
Les Congs en quelques chiffres :
- 11 conférences le matin
- 12 slots de barcamp l’après-midi
- 1 app releasée durant les Congs
- 1 doc de bonne pratique lancée
- 75 personnes le samedi matin dans l’amphi, à écouter les conférences (un peu moins le dimanche matin, après la soirée arrosée, parce que comme là dit un illustre inconnu : ‘ce matin, on a 50% de perte)
- 3 repas complétement pris en charge par l’organisation
- un peu plus de 100 dosettes de Senseo utilisés sur les deux jours (mais qu’une dizaine de sachet de thé, on le sait tous, le café est supérieur au thé)
- 200 litres d’eau bus, au bas mot, parce que dans le sud, il fait chaud, Cong !
- Quelques bonnes dizaines de coup de soleil, cadeau surprise pour ceux qui n’ont pas l’habitude du vrai soleil du vrai sud.
- 36 litres de bières (edit : j’avais oublié les 6litres de guinness) et 20 litres de vin bu lors des 6h qu’à durer la soirée du samedi soir. Et pourtant tout le monde est rentré sur ses jambes.
- Un nombre de kilo de paella engloutis par nos estomacs, qui fait juste peur. Comme quoi les poneys, ils ont bon appétit.
- un article dans Linux Magazine dans le prochain numéro.
Les Congs du point de vue d’un organisateur.
La deuxième édition fut l’occasion d’essayer d’être plus pro dans l’organisation des choses. Et je pense qu’on a fait plus qu’essayer.
- Plus de salles dont un amphi bien équipé niveau son (Merci encore à l’école centrale de Marseille nous avoir accueilli pendant ces deux jours).
- Plus de préparation au niveau des repas. On a remplacé les réservations dans de multiples restos par des plateaux repas et des sandwitch livrés sur site, pour gagner du temps et permettre de continuer en mangeant les discussions entamées pendant les confs.
- Une vrai préparation pour la soirée du samedi (à la Boate) et pas juste un ‘on va sur le vieux port et on trouve un resto comme l’année dernière).
- Quelques choix un peu clivant comme des durées de conf courtes ou du #Nowificonf pendant une partie des Congs.
- Moins de trajet dans ma voiture pour chercher les gens perdus ou les ramener. Marseille commence à priori à être connu de tous et il n’y a plus de femme enceinte parmi les présentes :).
- Encore plein de points à parfaire ou à juste faire (comme prévoir l’impression des badges en avance et les donner le premier matin, à l’arrivée. Ou prévoir un vrai carnet de route de l’accompagnant avec activités et truc à faire pour ne pas lâcher les gens comme ça et qu’ils s’ennuient pendant deux jours).
Les congs d’un point de vue perso.
Vivement la troisième édition. Comme les deux premières fois, la fin des Congs arrivant, un grand sentiment de vide se fait sentir et à peine le dimanche soir arrivé, l’envie d’être déjà à l’année prochaine, de pouvoir discuter à nouveau en IRL avec des gens que je ne vois parfois qu’une fois par an.
D’un point de vue perso, l’année dernière avait été une grande claque technique dans ma figure. Deux jours de conférences non stop, ça en met plein les mirettes.
Cette année, malgré le fait qu’il y est moins de conférences ce fut encore mieux. Les confs auxquelles j’ai pu assister m’ont en effet fait découvrir plein d’outil qu’il va falloir que je test, mais les barcamps ont permis d’échanger pour de vrai, de commencer même pour certaines sessions à poser les premières pierres de quelques choses (je pense là a Geek sans Frontière par exemple).
Mais ce n’est pas tout. L’un des points qui fait que cette deuxième édition fut immensément mieux que la première c’est que cette année la partie ‘non technique’ a été pensée et organisée. Et autant sur des découvertes techniques, on peut imaginer les faire par IRC / billets de blog, autant rencontrer les gens et se rendre compte qu’on les apprécie, pour de vrai, hé ben, y a pas à dire, il faut être dans la même pièce.
On mange difficilement de la barbe à papa rose sur IRC. Apprendre le GO, c’est aussi un peu compliqué. Et je ne parlerais même pas de jouer à ‘il était une fois’ avec Kael, Cyberj et Exirel. Ou de tenter de survivre à une partie de Pandémie. Et comme ArmagnacOverIP n’existe pas encore, on a encore besoin que dzen ramène sa bouteille dans son sac pour y gouter (je ne t’oublie pas brutasse, ta chartreuse était très bonne aussi:) ). C’est tout ces moments là. Tout ces moments partagés qui font que pour de vrai, DjangoCong 2.0, putaing, c’était terrible.
Et à l’année prochaine, pour d’autre aventure et une djangoCong 3.0
quelques liens :
- le convore des articles de blog qui parlent des Congs
- le convore des slides des confs
- le groupe djangofr sur linkedin
- l’etherpad de debrief collaboratif