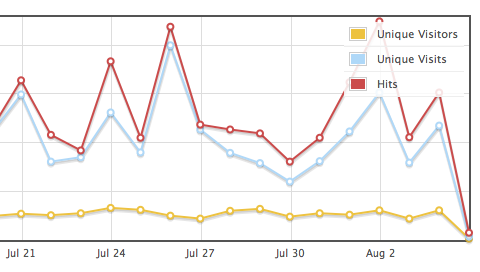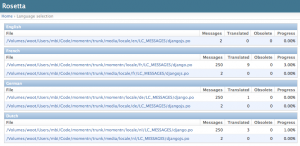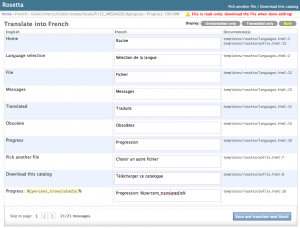Et non, vous ne rêvez pas, on est même pas le 15 avril et déjà, déjà, le billet de l’app django du mois est là. Mais bon, les rencontres django ayant lieu dans maintenant 14 jours et n’ayant pas encore commencer à préparer ma conf, même pas le premier mot (enfin si, bonjour), ce qui fait que je suis ‘dans la banade’, comme l’a fait si justement remarquer il y a peu @daks_
Donc, je préfère me ‘débarrasser’ tout de suite de l’app du mois, comme ça, ça sera au moins une chose de faite.
Ce mois-ci, je vais donc vous présenter django-request, une app pour faire des stats sur la fréquentation de votre django. Oui je sais il y a google analytics pour ça. Mais bon, on sait jamais, ça peut être utile quand même.
1- Où on le trouve, comment on l’installe, tout ça quoi (et la doc) ?
On le trouve à deux endroits :
- sur le github qui va bien
- sur les pages dédiées sur le site de son auteur.
A noter que quasiment toute la doc se trouve être sur la partie dédiée à django-request sur le site de son auteur.
Pour l’installation, facile, un git clone, un téléchargement de source ou alors pip et easy_install.
Quand à la doc, elle est vraiment très fournie et complète, permettant d’installer, de configurer, d’utiliser, la totale quoi.
2- A quoi ca sert ?
Ben à faire des stats, je l’ai déjà dit. Qui ne seront visibles que dans la partie admin.
On peut avoir de jolis graphiques concernant :
- les visiteurs uniques
- les visites basées sur des referrer différents
- les requêtes reçues par le serveur
- les requêtes venant des moteur de recherches
- les requêtes provenant du javascript
- les requêtes en SSL
- les requêtes faites par un utilisateur
- le nombre d’erreur 404
- le nombre d’erreur, toutes erreurs comprises
- le nombre d’utilisateur enregistré sur le site qui ont fait des requêtes
Par défaut les calculs seront fait pour les visiteurs uniques, les visites en fonctions des referrers et le nombre global de requêtes.
On obtient ensuite un joli petit graphique qui nous donne tout plein d’infos. Et plein de petits tableaux pour en avoir encore plus.
Et on peut même avoir, des petits templates tags pour voir les users actifs sur le site
3- Comment ça marche ?
Il suffit d’ajouter ‘request’ dans ses installed_apps et d’ajouter le middleware qui va bien. (Attention suivant les middlewares déjà installés, la position du middleware de django-request, dans le tuple des middleware est importantt, mais c’est bien expliqué dans la doc).
Ensuite, tout ce passe dans l’interface d’admin
4- Tips de chez Jmad.
Quand j’ai installé le tout avec easy_install, j’ai oublié de rajouter les chemins pour avoir les templates admins de l’app. Résultat je n’avais rien dans l’admin. Faites y attention ou alors installez request directement dans votre projet django, comme une de vos apps.
Le model Request présente un champ language qui est modélisé en bd par un varchar de 25. Avec mes tests, cette longueur était bien trop petite pour mon firefox. Du coup boum une erreur BD a base de ‘machin qui a été truncated’. J’ai passé la taille du champ à 200 pour être tranquille.
Les différents fichiers js qui sont utilisés sont bien entendu fournis. Pourtant par défaut, les templates vont utilisés ceux hostés ailleurs (sur le site web de l’auteur par exemple). N’oubliez pas de changer cette option si cela vous dérange.
C’est expliqué dans la doc, mais je le redis ici. Une fois que tout est bien configuré, pour aller voir ces stats, vous allez dans l’admin, vous cliquez sur la ligne Request de l’app Request. Là vous avez la liste de toutes les requêtes. (pas très utile là comme ça, vous me direz). Levez les yeux, en haut à droie, à coté du bouton Add Request, vous avez un bouton Overview. Et voilà, cliquez, vous avez vos stats.